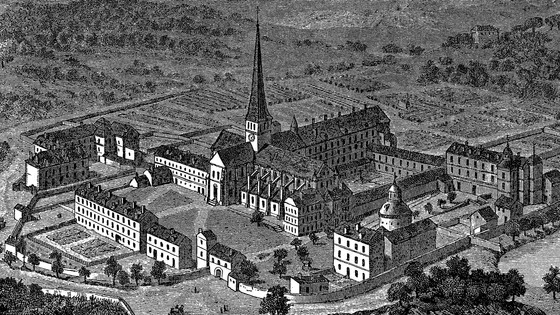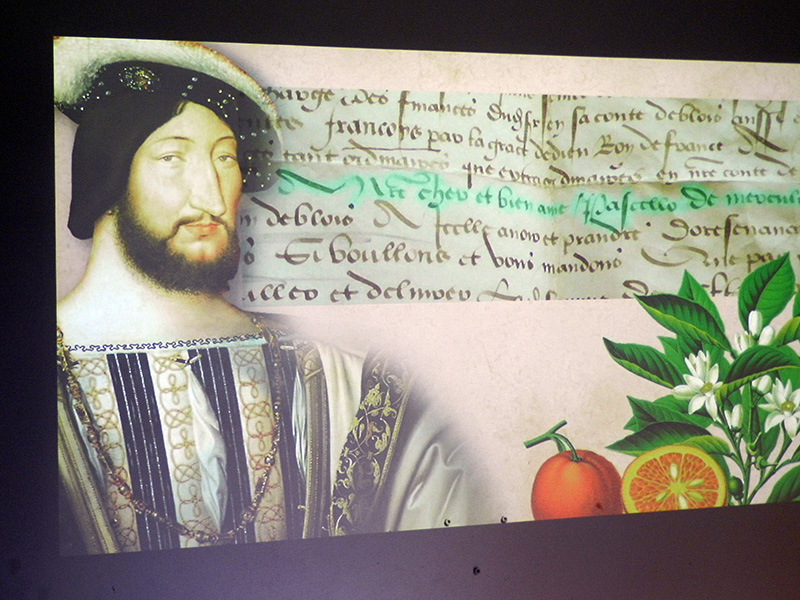ADRIANA PEDICINI

Magia e tradizione
Nella nostra società si possono individuare varie categorie di sopravvivenza che legano indissolubilmente l’uomo al suo passato il quale di volta in volta si ripropone e ogni volta con maggiore suggestione. Tra esse un posto rilevante occupa la magia.
Certamente la magia si può definire la forma originaria del pensiero umano. Essa sarebbe esistita un tempo allo stato puro e l’uomo avrebbe pensato in origine solo in termini magici. La predominanza dei riti magici nei culti primitivi e nel folklore costituisce, si pensa, una prova importante a favore di tale ipotesi.
L’uomo primitivo infatti avvertiva il bisogno di dominare le forze della natura e della vita in virtù di particolari poteri che prescindevano dal riconoscimento e dall’implorazione a un Essere superiore.
Di qui la messa in pratica di superstizioni e credenze né religiose, né scientifiche, cosa che sussiste nella società attuale sotto le forme dello spiritismo e dell’occultismo.
Due sono le forme fondamentali di magia che muovono da due principi diversi:
1) il simile agisce sul simile, magia imitativa dunque o simbolica
2) la parte agisce sul tutto.
Tuttavia la magia contiene dappertutto gli stessi elementi essenziali, quindi è identica dappertutto.
Non è utile procedere secondo l’analisi, anche se molto esauriente, di un numero pur considerevole di cerimonie magiche.
La magia è infatti debolmente istituzionalizzata e si presenta come un insieme di azioni e credenze mal definito anche per chi la pratica o ci crede.
Grande importanza comunque ha la tradizione.
Infatti i riti magici e l’intera magia sono fatti di tradizioni. Atti che non si ripetono non sono magici. Atti alla cui efficacia non crede un intero gruppo non sono magici. La forma dei riti è trasmissibile ed è avvalorata dall’opinione comune.
Donde consegue che atti strettamente individuali, come le pratiche superstiziose particolari dei giocatori prima di un evento sportivo, non possono essere chiamati magici.
Esistono al contrario altri riti che sono regolarmente ritenuti magici come i malefici. Essi sono costantemente qualificati in tal modo dal diritto e dalla religione. Illeciti, sono espressamente puniti e proibiti.
A questo punto è evidente che c’è antagonismo tra rito magico e rito religioso.
Innanzitutto riti magici e riti religiosi hanno agenti diversi. Ma ci sono molti altri elementi distintivi: la scelta dei luoghi ove deve svolgersi la cerimonia magica. Questa non si attua nel tempio o sull’altare domestico; ordinariamente si svolge nei boschi, lontano dalle abitazioni, durante la notte o nell’ombra. Diversi sono anche i mezzi utilizzati e sentimenti che suscitano.
Sicuramente la magia determina un fortissimo condizionamento su menti deboli e su persone di scarsa cultura, di scarsa “fortuna” o pressate da eventi spiacevoli.
Vi sono intere categorie sociali che, pur non appartenendo apertamente alle tipologie precedentemente indicate, in realtà possono essere qualificati personaggi la cui dimensione esistenziale assolutamente esteriore e legata a fattori che essi stessi sentono labili e precari cercano il consolidamento di se stessi al di fuori di sé, in ambiti ritenuti capaci di suggestionare la soddisfazione dei bisogni.
Già nell’antica Roma tuttavia il Collegio romano dei Pontefici osteggiava il ricorso a pratiche magiche che non avessero come punto di riferimento la divinità. Questa era invocata per ottenere la soddisfazione di un voto diretto non al vantaggio di una sola persona, ma al bene della comunità: scampo da pericoli e malattie, incremento del raccolto e del bestiame, vittoria sul nemico erano i desideri più ricorrenti. Per il raggiungimento di essi si servivano di un armamentario di gesti e di formule di tipo magico basato sull’elementare sofisma “post hoc, ergo propter hoc”, e sull’innato senso di un’affinità che si ritiene colleghi oggetti simili o aventi relazioni tra di loro come parte di un tutto.
La lustratio agri
Ad esempio la cerimonia della lustratio agri, rito diffusissimo a Roma, consisteva nella purificazione apotropaica dei campi al fine di liberarli da potenziali pericoli come aridità e malattia. Forse il primo a utilizzare tale rito fu Servio Tullio il quale secondo la tradizione stabilì per primo la consuetudine di procedere al lustrum del census (di qui la cadenza quinquennale del lustrum).
Non era questa però l’unica applicazione di tale pratica cultuale. Oltre al rituale della lustratio aquae si sa, ad esempio, che nel campo Marzio, animali sacrificali venivano condotti intorno all’esercito in armi o al popolo in assemblea in funzione di purificazione apotropaica. Questo rituale, veniva chiamato lustrum da cui la forma verbale lustrare impiegata anche da Virgilio.
Leggiamo in Catone, II sec.a.Ch. (De agricoltura cap. 141,1-3)
“Bisogna purificare il podere in questo modo: comanda che le tre vittime, porco, agnello e vitello, siano condotte in giro intorno al campo pronunciando queste parole:” Col favore degli dei e perché tutto mi vada bene io ti ordino, o Manio, che queste tre vittime siano condotte in giro per il fondo, il podere, la terra mia, o solo per quella parte che tu giudichi debba essere purificata”.
“Invocate prima Giano e Giove, e dopo aver bevuto direte così: Oh padre Marte, ti prego e ti imploro di volere essere propizio a me, e alla mia famiglia: per questo motivo quindi ho disposto che si facesse, attorno al mio campo, attorno alla mia terra ed attorno al mio fondo il sacrificio di un porco, di una pecora e di un toro: affinché tu impedisca, tu difenda ed allontani le malattie curabili ed incurabili, la sterilità e le devastazioni del suolo, le calamità e le intemperie, e affinché tu aumentassi e concedessi di prosperare alle messi, al frumento, alle vigne ed ai virgulti; salvassi e proteggessi i pastori e il bestiame, e concedessi buona salute e forza a me, alla mia casa ed alla mia famiglia; quindi è necessario purificare queste stesse cose, il fondo la terra e il mio campo, rendendo sacrificio così come dissi: sii onorato dal sacrificio di questi suovitaurili lattanti”.
Cato de agri c. 141: [1] Agrum lustrare sic oportet: impera suovitaurilia circumagi: «Cum divis volentibus quodque bene eveniat,/ mando tibi, Mani,/ uti illace suovitaurilia/ fundum agrum terramque meam,/ quota ex parte sive circumagi sive circumferenda censeas,/ uti cures lustrare». [2] Ianum Iovemque vino praefamino, sic dicito:/ «Mars pater,/ te precor quaesoque/ uti sies/ volens propitius/ mihi domo familiaeque nostrae:/ quoius rei ergo/ agrum terram fundumque meum/ suovitaurilia circumagi iussi;/ uti tu/ morbos visos invisosque,/ viduertatem vastitudinemque,/ calamitates intemperiasque/ prohibessis defendas averruncesque;/ utique tu/ fruges frumenta,/ vineta virgultaque / grandire dueneque evenire siris;/ [3] pastores pecuaque/ salva servassis/ duisque duonam salutem valetudinemque/ mihi domo familiaeque nostrae;/ harunce rerum ergo/ fundi terrae agrique mei lustrandi/ lustrique faciendi/ ergo,/ sicuti dixi/ macte hisce suovitaurilibus lactentibus immolandis esto;/ Mars pater,/ eiusdem rei ergo/ macte hisce suovitaurilibus lactentibus esto». La formula ‘fundum agrum terramque meam’
Cominciamo dalla seconda. Nel lungo testo della precatio catoniana questa ritorna tre volte: in 141. 1, 6 (fundum agrum terramque meam); in 141. 2, 8 (agrum terram fundumque meum) e in 141. 3, 6 (fundi terrae agrique mei lustrandi).
È noto agli studiosi che anche in altre antiche preghiere si trovano spesso ripetizioni triple in funzione enfatica come ad esempio nel caso di precor veneror veniamque peto, o di metum formitudinem obliuionem, ovvero di fuga formidine terrore. Si può fare l’esempio del carmen di evocatio di Cartagine e lo stesso Gellio dice che Catone usava impiegare tre vocaboli dallo stesso significato per dare l’idea di una grande prosperità: Gell. 13. 25. 13: Item M. Cato in orationis principio, quam dixit in senatu pro Rodiensibus, cum vellet res nimis prosperas dicere, tribus vocabulis idem sententibus dixit.
Non sembra però sia questo il caso.
Ager, fundus e terra
Nel lessico dei giuristi dell’età classica sappiamo che ager, fundus e terra avevano dei significati ben precisi e diversi.
In un frammento tratto dal 17 libro ad edictum di Ulpiano leggiamo ad esempio che (D. 50. 16. 27): Ager est locus, qui sine villa est. Ancora, in D. 50. 16. 60 (lib. 69 ad edictum), leggiamo che per i più: Locus est non fundus, sed portio aliqua fundi: ‘fundus’ autem integrum aliquid est. et plerumque sine villa ‘locum’ accipimus. Mentre il giurista dell’età dei Severi dimostra di avere un’idea diversa: ceterum adeo opinio nostra et constitutio locum a fundo separat, ut et modicus locus possit fundus dici, si fundi animo eum habuimus. non etiam magnitudo locum a fundo separat, sed nostra affectio.
Attraverso Ulpiano risaliamo anche a Labeone dal quale deduciamo che il termine locus si applicava di regola ai terreni rustici (anche se poteva essere usato per indicare i praedia urbana) e che la nozione di fundus veniva assimilata alla moderna nozione di ‘particella’ (sed fundus quidem suos habet fines). Il locus, inoltre, come espressione di un possesso immobiliare, sembra che per Labeone riguardasse in genere estensioni di terreno senza confini (locus vero latere potest, quatenus determinetur et definiatur). Di qui l’espressione locupletes ampiamente usata nelle fonti della tarda repubblica/età augustea.
Il quadro si chiude con Florentino il quale definisce il fundus come un’ager su cui c’era anche una costruzione. Mentre il locus, è considerato un terreno senza costruzione che si definiva ‘area’ in città e ager nelle campagne:
D. 50. 16. 211 (Florent. 8 inst.): ‘Fundi’ appellatione omne aedificium et omnis ager continetur. sed in usu urbana aedificia ‘aedes’, rustica ‘villae’ dicuntur. locus vero sine aedificio in urbe ‘area’, rure autem ‘ager’ appellatur. idemque ager cum aedificio ‘fundus’ dicitur.
Come si vede, nella tradizione giuridica romana (a partire da Labeone), i vocaboli ager e fundus presentano dei significati affatto diversi. Inoltre, si può notare che nella costruzione dogmatica dei giuristi classici, mentre il concetto di terra tende a scomparire, quello di locus sembra assumere un ruolo sempre più centrale.
Quest’ultima circostanza forse dipende dal fatto che il legislatore del 111 a. C. per indicare i possedimenti di terra in Italia (ma anche in Africa e Grecia) scelse di adoperare insieme a quello di ager anche i concetti di locus e di aedificium.
La lustratio agri però appartiene all’epoca di Catone ed è un testo che come abbiamo visto si proietta nel passato. Quindi il principale referente per noi non può essere che Varrone, il quale, fu allievo di Elio Stilone. Esperto, come è noto, anche di diritto augurale e autore di quegli Aeliana studia che rappresentano uno dei modi attraverso i quali l’antico sapere italico (etrusco?) si trasmise nella scienza dei giuristi dell’ultimo secolo della repubblica.
Poiché è molto probabile che Stilone abbia scritto anche un commento alle XII Tavole di poco successivo ai Tripertita, è altrettanto possibile che le definizioni di Varrone esprimano dei concetti che risalgono almeno all’epoca di Sesto Elio. Aggiungerei che l’assenza del termine locus nel lessico della lustratio forse è indice del fatto che la redazione del testo della formula sia anteriore all’epoca dell’affermazione della villa in Italia.
Ed allora, in Varrone (l. L. 7. 2. 18) leggiamo che: ‘ager non est terra’ perché il concetto di ager era un concetto tecnico che derivava dal diritto augurale (Varro l. L. 5. 5. 33). Anche il concetto di terra, come dice Stilone, era presente negli scritti degli àuguri, ma in un significato più generico: Varro l. L. 5. 4. 21: Terra dicta ab eo, ut Aelius scribit, quod teritur. Itaque tera in augurum libris scripta cum R uno. A proposito dell’ager invece leggiamo: l. L. 5. 6. 34: Ager dictus in quam terram quid agebant, et unde quid agebant fructus causa. Ed anche il fundus è descritto in Varro l. L. 5. 6. 37 già come una porzione di terreno produttiva di frutti, sia come un terreno adibito al pascolo (ager quod videbatur pecudum ac pecuniae esse fundamentum), il fundus sembra un terreno adibito alla coltivazione prevalentemente arbicola (fundus dictus, aut quod fundit quotquot annis multa).
A questo punto mi pare difficile pensare che Catone abbia potuto usare la formula ‘agrum terram fundumque meum’ senza avere alcuna consapevolezza della diversità di significato di tali vocaboli. Questi tre termini della forma lustrale, del resto, sono rappresentativi di un’epoca in cui il possesso dell’ager publicus era per definizione ancora precario e il complesso passaggio dal diritto augurale a quello laico nella riflessione dogmatica dei giuristi doveva essere appena agli inizi.
Prima di concludere resta da esaminare brevemente la formula ‘mihi domo familiaeque nostrae’. Essa rileva in due luoghi della lustratio (141. 2, 6 e 141. 3, 4), ma anche in Cato de agri c. 134. 2, dove è riportata la liturgia del rito della porca praecidanea; e in Cato de agri c. 139, dove c’è il testo di un piaculum espiatorio.
In questo caso non dovrebbero esserci dubbi sul fatto che il termine familia nella formula di tali rituali fosse ancora impiegato nel suo significato più antico di ‘insieme di famuli’, ovvero di familia rustica nel senso di ’addetti alla coltivazione del fondo’. Si aggiunga che è molto probabile che nel lessico dei Tripertita di Sesto Elio (di pochi anni anteriore al de agri cultura la cui pubblicazione cade nel trentennio 180/150 a. C.) il testo della norma decemvirale sulla volontà testamentaria fosse reso nella forma retorica con la formula familia pecuniaque nel significato di ‘schiavi’ (=famuli) e forse anche di ‘bestiame’.
Quanto al vocabolo domus, esso deriva dalla radice indoeuropea *dem– (o *dom-) nel significato di ‘edificare’ o ‘costruire’, come in greco devmo=’edificare’ o dovmoS=’casa’. Per tale motivo, ad esempio, in russo, in lituano e in latino, il concetto di ‘casa’ viene reso rispettivamente con i vocaboli dom, namas, e domus.
Facciamo a questo punto un confronto tra l’espressione catoniana domo familiaeque meae e la famosa definizione ulpianea in cui il giurista definisce pater familias colui qui in domo dominius habet, ma anche che recte eiusdem familiae appellabuntur, qui ex eadem domo et gente proditi sunt. Avviandomi a concludere mi chiedo. Perché nella formula lustrale di Catone compare l’endiadi domo et familia, mentre in Ulpiano al vocabolo domo viene affiancato quello di gens?
Se si tiene conto del fatto che a livello istituzionale la cd. familia proprio iure si affermerà nella società romana solo alla fine dell’età repubblicana – e che, grosso modo, solo dalla stessa epoca le fonti atecniche cominciarono ad usare sempre più spesso il vocabolo familia in luogo di gens, – possiamo pensare che, evidentemente, prima ancora che nella terminologia dei giuristi romani si consolidasse l’uso del termine familia per indicare le varie tipologie di raggruppamenti familiari (familia proprio iure e communi iure), nel linguaggio colto il termine domus venisse impiegato in un significato forse molto più ampio.
In un‘epoca in cui (l’epoca catoniana) con il termine familia veniva indicato molto probabilmente il ‘gruppo di persone addette alla lavorazione del fondo agricolo’, evidentemente, con domus si indicava sì, la dimora in senso materiale, ma anche in senso tecnico e figurato l’insieme degli stretti congiunti del pater. Evidentemente a causa di un processo di identificazione tra la ‘casa’ come ‘sede del gruppo’ e il gruppo stesso.
Bibliografia
Apuleio, De magia.
Celso, De medicina.
Ovidio, Metamorfosi.
Sacchi Osvaldo, Spunti per un’archeologia giuridica del linguaggio. Suggestioni ancestrali e terminologia giuridica nella Lustratio agri in Cato De Agri c. 141, online: https://dirittoestoria.it/iusantiquum/articles/Sacchi-Archeologia-giuridica-del-linguaggio.htm
Von Albrecht Michael, Storia della letteratura latina, Einaudi, Torino 1997.